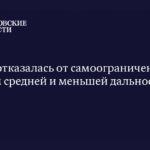Durant deux chaudes journées de week-end du mois d’août 1989, étonnamment riche en champignons, plus précisément les 12 et 13, alors que les résidents secondaires près de Moscou cueillaient des cèpes juste à côté de leurs clôtures, la capitale soviétique fut secouée par un festival sans précédent.
Malgré son nom officiel et routinier—Moscow International Peace Festival / Moscow Music Peace Festival—ce n’était pas seulement un festival de musique, mais un festival de rock, et avec une programmation incroyablement starifiée. Au stade Loujniki, qui à l’époque, comme tout le reste dans le pays, portait le nom de V.I. Lénine, les esprits des Soviétiques non-initiés furent époustouflés par le gratin de la scène heavy metal mondiale : Ozzy Osbourne, Jon Bon Jovi, Scorpions, Mötley Crüe, Skid Row, Cinderella.
Pour être juste, les jeunes Moscovites n’étaient pas complètement novices : ils connaissaient et aimaient ces groupes, et des géants du rock comme Uriah Heep et Pink Floyd avaient déjà donné des concerts dans la capitale, mais Moscou n’avait jamais vu une telle concentration de stars du rock.

Dans une ville où, peu de temps auparavant, la police et les patrouilles de volontaires réprimaient ceux qui tentaient de se lever de leur siège, de danser et d’exprimer ouvertement leurs émotions, des dizaines de milliers de jeunes se lâchaient maintenant au son du rock énergique, sauvage et puissant—il était difficile de croire à ce qui se passait, mais cela se déroulait devant un public immense—le festival a attiré 120 000 personnes sur 2 jours.
Les billets étaient assez chers pour le Moscovite moyen, compte tenu du calibre de la programmation, et ils finirent par être vendus à trois fois moins que leur prix initial, ce qui contribua grandement à la popularité exceptionnelle de l’événement. De plus, MTV diffusa le festival dans 59 pays à travers le monde.

À l’échelle historique, le festival est devenu l’un des événements marquants de ces grands changements survenus dans le vaste État soviétique s’ouvrant au monde, et une démonstration de la nouvelle amitié américano-soviétique après trois décennies de Guerre froide. Il a largement inspiré le fameux hymne rock des Scorpions, « Wind Of Change », dont le groupe était l’une des têtes d’affiche.
Mais tout n’était pas si simple—bien au contraire. Comment ce festival a vu le jour, comment tout cela a été possible—c’était une question que beaucoup de responsables soviétiques ont dû se poser.
C’était une époque étrange et charnière où tout craquait déjà de partout, avec des écrous et des boulons qui sifflaient sous la tension de l’accélération, de la glasnost et de la perestroïka—les tentatives de réforme du système soviétique.
Mais ne croyez pas que pour réaliser quelque chose comme cela, il suffisait d’être un rêveur et un visionnaire. Il fallait aussi être Stas Namin, qui fut l’inspirateur et l’organisateur du festival de notre côté.

Il faut préciser que le musicien et producteur Stas Namin était, en termes de nomenclature soviétique, un authentique « prince ». Petit-fils du commissaire du peuple de Staline, Anastas Mikoyan, dont il porte le prénom, il était un représentant modèle de la « jeunesse dorée »—beaucoup de choses lui étaient permises.
Dans les années 1970, son groupe « Tsvety » (Fleurs) était le plus hippie des « ensembles vocaux-instrumentaux » officiels. Et dès le début de la perestroïka, il parvint à créer le Centre Stas Namin au « Théâtre Vert » du parc de la Culture et des Loisirs Gorki, qui comprenait, entre autres, un label de disques et la première station de radio privée.
À cette époque, Namin produisait le groupe de rock d’exportation spécialement créé, Gorky Park, destiné au marché américain. Naturellement, ils participèrent au festival et sortirent leur album de début aux États-Unis juste après. Cela donne une idée de l’envergure de Stas Namin. Mais même pour quelqu’un comme Stas Namin, organiser un tel événement était un défi de la plus haute importance.

Du côté américain, la figure clé parmi les organisateurs était son ami, le producteur de musique Doc McGhee. C’est lui qui a aidé